Voici donc la suite (mais pas encore la fin) de mon premier article sur la Belgique et ses problèmes linguistiques.
Dans cet article, je ferai un résumé (très bref et forcément incomplet) de l'histoire de la Belgique du point de vue linguistique, ce qui me paraît nécessaire avant d'aborder franchement les problèmes communautaires actuels. En sachant que la Belgique, en elle-même, a une histoire très très riche et qu'elle ne se réduit absolument pas à cet aspect linguistique. Mais puisque j'ai décidé d'en parler de ce point de vue, je continue vaille que vaille ! :-)
La formation de la frontière linguistique séparant la Flandre de la Wallonie en Belgique ne date pas d'hier, c'est le moins que l'on puisse dire. En fait, elle remonterait à la fin de l'Empire romain et aux invasions par les « Barbares » germaniques des régions correspondantes.
À cette époque, ce qui deviendra bien plus tard la Belgique était donc placée sous le pouvoir romain. Mais ces derniers n'occupaient pas uniformément ce territoire. En fait, ils étaient principalement installés au sud de celui-ci et autour d'une voie romaine très importante à l'époque qui allait de Bavay (aujourd'hui en France, près de la frontière belge) à Cologne, en Allemagne.
Les gens qui étaient établis à ces endroits parlaient des dialectes latins, lesquels dialectes évolueront plus tard vers des « langues d'oïl » (famille de langues latines dont fait partie le français), dont le wallon, le picard, le lorrain, etc. Plus au nord de cette voie romaine, les Romains étaient peu implantés, et de fait les terres étaient marécageuses et peu hospitalières.
Lorsque que les tribus germaniques envahirent ces contrées, ils imposèrent d'autant plus facilement leurs dialectes au nord de cette fameuse voie romaine, que la présence romaine y était sporadique. En revanche, autour et au sud de la voie Bavay-Cologne, la présence latine étaient tellement importante que ce sont les envahisseurs qui se « latinisèrent » au fil du temps.
Et ainsi se forma en Belgique la frontière linguistique actuelle, en suivant (grossièrement) une parallèle à cette voie romaine, globalement un peu plus au nord.…
Cette frontière linguistique est demeurée au fil des siècles étonnamment stable, du moins sur ce qui allait devenir le territoire belge. Elle y a certes subi quelques modifications, mais aucun véritable chamboulement. Tandis que juste à côté, dans le nord de la France, elle a en revanche régréssé nettement en faveur du français, surtout au cours des siècles récents, ainsi que le montre cette carte :

Désolé, la légende est en néerlandais…« Taalgrens » signifie « frontière linguistique », « taalgebied » désigne le domaine où l'on parle une langue donnée, « eeuw » signifie « siècle », « tweetalig » veut dire « bilingue ». Le reste devrait être compréhensible, enfin j'espère.
Il convient d'ailleurs de noter que la frontière linguistique n'a jamais eu aucun effet sur les différents régimes qui s'établirent dans ces régions. En fait c'est seulement de nos jours qu'elle a obtenu un rôle politique important. Autrefois, les comtés de Flandre, du Hainaut, le duché de Brabant, la principauté de Liège, etc., s'étendaient de part et d'autre de cette « frontière ». Ce qui est somme toute assez logique : à l'époque, les dialectes parlés par le « vulgaire » n'étaient pas vraiment (euphémisme) le souci le plus important de leurs dirigeants, qui communiquaient entre eux, selon les cas, en latin, en « thiois » (l'ancêtre du néerlandais), en français, etc.
Et puis, au milieu du XVIe, arrivent les guerres de religion…
À cette époque, ce qui est équivaut à peu près à la Belgique et aux Pays-Bas actuels est appelé globalement « Pays-Bas » et est sous la coupe du très catholique royaume d'Espagne. Mais la Réforme protestante a lieu et connaît dans ces régions un très important succès. L'Espagne, représentée en particulier par le sanglant duc d'Albe, parvient au prix de luttes sanglantes, à conserver la main-mise sur la partie sud de son fief.

Le tristement célèbre duc d'Albe
Cette partie sud reste donc, par la force des choses, catholique, et sera appelé désormais les Pays-Bas « catholiques » ou « méridionaux ». On est très proche de la Belgique actuelle, plus le Luxembourg et exception faite de la principauté de Liège, sous tutelle du Saint-Empire romain germanique.

Scission des Pays-Bas méridionaux et septentrionaux.
Une conséquence directe de ce conflit est que le néerlandais, considéré comme la langue des « hérétiques » perd tout droit de cité dans les Pays-Bas catholiques, au profit du français. Encore une fois, cela ne concerne guère le peuple lui-même, qui continue à parler ses dialectes. Mais à partir de cette date le français est l'unique langue des classes dirigeantes.
Deux siècles plus tard, cet état de fait est renforcé par la conquête des Pays-Bas catholiques par la France en 1795. C'est à cette époque que sont tracées les limites des provinces belges actuelles.
Après la chute de Napoléon en 1815, les Pays-Bas du nord et du sud sont réunifiés en un seul pays, le royaume des Pays-Bas. C'est l'occasion pour son souverain Guillaume Ier d'essayer de réintroduire le néerlandais comme langue officielle en Flandre, et à terme comme langue véhiculaire du pays tout entier, à l'image du castillan pour l'Espagne. Mais cette politique déplaît aux élites du sud du Pays-Bas, francisées depuis longtemps, qui se plaignent également d'être sous-représentées au plus niveau des instances dirigeantes. Ajoutez à cela l'influence de l'Église catholique, pour qui ce qui vient du nord, essentiellement protestant, a des relents d'hérésie, et on aboutit à une révolution en 1830 et à la Belgique actuelle indépendante.
Ce pays neuf se dote alors d'une constitution très libérale assurant entre autres la iberté des langues au niveau individuel. Au niveau national le français devient la seule langue officielle du pays : ce qui est logique puisque c'est la seule langue de la classe dirigeante maintenant au pouvoir, flamande comme wallonne. Il s'agira donc de la seule langue enseignée dans les écoles, et de la seule langue utilisée dans les hautes sphères du pouvoir.
Mais à partir de cette date, du fait de l'accès plus important à l'éducation et de l'élargissement de la classe moyenne à cette époque de progrès industriel effréné, se crée un mouvement pour la reconnaissance de la spécificité néerlandophone du nord de la Belgique, c'est-à-dire au nord de la frontière linguistique (la Flandre actuelle), là où les dialectes populaires sont de la famille du néerlandais, et non du français. En revanche, le français s'impose assez naturellement au sud de cette frontière (la Wallonie actuelle), où les dialectes sont quasi tous de la même famille linguistique que le français.
En conséquence de ce mouvement, la Belgique devient officiellement bilingue, français-néerlandais, en 1898. Il n'est pas encore question de l'allemand comme langue officielle : les futurs « Cantons de l'Est » ne seront incorporés à la Belgique qu'après la première guerre mondiale.
Ceci étant, du fait du « prestige » et de la bien plus grande portée internationale et culturelle de la langue française à l'époque, et malgré le fait que les Flamands soient assez nettement majoritaires dans le pays, les classes dirigeantes restent essentiellement francophones. Et le français reste donc la langue à savoir absolument si l'on souhaite s'élever socialement. Cet état de fait a perduré jusqu'à ces dernières décennies. De quoi créer et aviver un certain ressentiment chez les Flamands, ressentiment qui perdure encore aujourd'hui.
À cette époque, cependant, craignant une propagation du néerlandais en Wallonie et à la capitale Bruxelles (où la population est néerlandophone d'origine, mais se francise progressivement au fil des ans), des voix s'élèvent pour obtenir la garantie que le sud de la Belgique, la Wallonie, reste francophone.
Cela mène à l'instauration en 1932 de l'unilinguisme régional : le français est officiellement unique langue officielle en Wallonie, le néerlandais en Flandre. Seule Bruxelles reste officiellement bilingue. La frontière linguistique est pour la première fois une réalité politique concrète. Elle reste cependant « mouvante ». Par le biais de consultations, des communes peuvent passer d'un rôle à l'autre si la langue majoritaire y change.
Ainsi des communes autour de Bruxelles, au départ uniquement néerlandophones, deviennent officiellement bilingues (ce qui signifie « francophone » pour la Flandre) et sont rattachées à la capitale, du fait de la croissance régulière de celle-ci. Ce phénomène de propagation du français autour de Bruxelles, appelé « la tâche d'huile » (olievlek) par les Flamands, contribue à polariser les esprits. Entre-temps, cependant, signe de la remontée du prestige du néerlandais, l'université de Gand, autrefois francophone, devient unilingue néerlandophone.
À cette époque, des mouvements nationalistes flamands voient le jour, ayant pour objectif la création d'une Flandre indépendante et délivrée de tout « impérialisme » francophone. Pour leur malheur, la plupart des leaders de ce mouvement se compromettent dans la collaboration avec l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, et le nationalisme flamand se trouve largement discrédité dans l'opinion dans l'immédiat après-guerre, pour faire surface à nouveau à la fin des années cinquante. Ainsi, à l'Exposition universelle de 1958, qui a lieu à Bruxelles, des manifestations suivies ont lieu pour que le pavillon belge, où les inscriptions sont uniquement en français, ait aussi des inscriptions en néerlandais.
Le mouvement flamand renaissant milite en particulier pour que cessent les recensements linguistiques et la propagation de la « tâche d'huile ». C'est chose faite en 1963 : la frontière linguistique entre la Flandre et la Wallonie est définitivement fixée et inscrite dans la constitution belge (ainsi que la partie germanophone de la Wallonie). En particulier Bruxelles et son bilinguisme français-néerlandais sont définitivement limités à 19 communes, enclavées en Flandre.
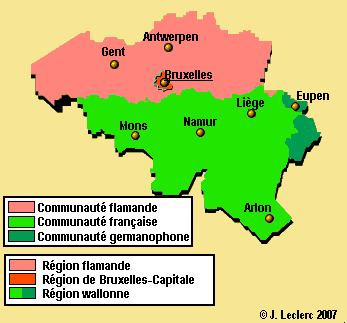
Les zones linguistiques de Belgique, fixées en 1963 et toujours en vigueur.
À cette occasion sont aussi créées les « communes à facilités ». Ils s'agit de quelques communes situées de part et d'autre de la frontière linguistique, mais aussi autour de Bruxelles, qui tout en restant officiellement unilingues (néerlandophones si elles sont situées en Flandre, francophones — ou germanophones — si elles sont en Wallonie), proposent à la population des « facilités » linguistiques : l'administration est tenue de correspondre avec l'administré dans la langue de celui-ci, si cette langue fait l'objet de ces facilités. Par exemple, un francophone résidant dans une commune flamande à facilités pour les francophones peut demander à recevoir ses documents officiels en français, et vice versa pour un flamand dans une commune wallonne à facilités pour les néerlandophones.
Pour l'anecdote, toutes les communes germanophones de l'est du pays sont à facilités pour les francophones, et des communes francophones avoisinantes sont à facilités pour les germanophones. Ces facilités-là ne posent pas de problème, au contraire des facilités francophones-néerlandophones, dont je vais parler bien plus en détail dans le prochain article…
C'est en 1968, année décidément fameuse entre toutes, qu'a lieu un élément déterminant pour la suite de l'histoire politique de la Belgique : la scission de l'université de Louvain.
L'université catholique de Louvain est une université très ancienne (15e siècle). Louvain (Leuven) est une petite ville flamande du Brabant, à 20 km à l'est de Bruxelles et proche de la frontière linguistique. À l'époque qui nous intéresse, son université, la plus importante du pays, était déjà divisé en deux sections distinctes, la flamande et la francophone, mais toutes deux basées à Louvain même.
Suite à la fixation de la frontière linguistique, des voix s'élevèrent pour réclamer le départ de la section francophone de Louvain : une université francophone en Flandre était selon elles en contradiction avec l'unilinguisme néerlandophone de la région. Ajoutez-y la fameuse crainte de la tâche d'huile (Bruxelles étant toute proche) et l'explosion du nombre d'étudiants en raison du baby-boom : le résultat fut plusieurs années (1963-68) de crise politique majeure et de manifestations estudiantines parfois violentes aux cris de Walen buiten! (Wallons dehors!).

Cela aboutit à la chute du gouvernement belge en 1968 et au départ effectif de la section francophone à Ottignies, dans le Brabant wallon, à une trentaine de kilomètres au sud de Louvain et Bruxelles, sur un site appelé dès lors « Louvain-la-Neuve ». La commune d'Ottignies changea de nom pour l'occasion et devint « Ottignies-Louvain-la-Neuve ». Ceci étant, cette université francophone s'appelle toujours « Université catholique de Louvain » (UCL), de même que son vis-à-vis néerlandophone resté à Louvain demeure la Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Cet événement a accéléré l'évolution de la Belgique vers l'état bicéphale que l'on connait actuellement : une des premières conséquences directes a été, dès 68 et durant les années 70, la scission des principaux partis politiques (socialiste, chrétien-démocrate et libéral) en sections flamandes et francophones entièrement indépendantes, aux points de vue irréconciliables, au départ sur Louvain et en général sur la question linguistique. Ce genre de scission n'a, à ma connaissance, aucun équivalent dans les autres pays multilingues européens.
Si bien qu'actuellement l'électorat wallon n'a aucune prise sur la politique flamande, et vice-versa, et la coupure du pays s'en est approfondie. Le seul endroit où les deux rôles linguistiques cohabitent demeure Bruxelles. Plus précisément, l'arrondissement dit de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), à cheval sur Bruxelles et une partie du Brabant flamand, sur lequel se concentre les tensions politiques actuelles. J'y reviendrai là aussi en détail dans le prochain article…
À partir de 1968, donc, l'évolution vers un état fédéral constitué de plusieurs entités différentes s'accélère. De réforme en réforme, on scinde de plus en plus de compétences administratives entre les deux principales régions, Flandre et Wallonie, et les deux principales communautés, flamande et francophone.
Le cas particulier de Bruxelles, ville officiellement bilingue, historiquement néerlandophone, mais aujourd'hui largement francophone dans les faits, est réglé définitivement (?) en 1989 : elle devient alors une région à part entière, constituée de 19 communes (dont la ville de Bruxelles même), mais cependant enclavée en Flandre.
Il reste alors à scinder en deux la seule province de Belgique traversée par la frontière linguistique (ailleurs la frontière linguistique coïncidait déjà avec les limites des provinces attenantes) : le Brabant. C'est chose faite en 1995 : au nord le Brabant flamand, au sud le Brabant wallon, et, entièrement enclavée en Brabant flamand, Bruxelles, devenue comme on l'a vu région à part entière. Simultanément la Belgique devient l'état fédéral, avec ses régions et communautés, que l'on connait maintenant et tel que je l'ai décrit dans le premier article.
Voilà pour la partie « historique » de cette série d'articles sur les problèmes linguistiques de la Belgique. Le prochain et dernier article traitera des sujets « qui fâchent » actuellement, et qui contribuent à plonger le pays dans une crise politique dont on ne voit pas encore le bout (démission du gouvernement Leterme, convocation d'élections fédérales pour le 13 juin)…


, le 06.05.2010 à 01:03
Bonjour à tous les cuksiens et cuksiennes.
C’est mon premier commentaire sur ce merveilleux site que je suis tous les jours. Je voudrais féliciter Frank pour ce très bon article, pour un sujet qui n’est pourtant pas évident même pour des Belges. Et en tant que Tournaisien, je le salue également !
Il y a juste une petite erreur de frappe dans l’avant dernier paragraphe. (frontière linguiste)
Je suis avide de lire la suite pour avoir ton point de vue “extérieur” sur bhv…
, le 06.05.2010 à 01:21
Merci Samd ! :-) Et pour l’erreur, je viens de corriger.
, le 06.05.2010 à 02:31
Il y a quelques semaines, à la lecture du premier papier, j’avais été impressionné par les talents à la fois pédagogiques et diplomatiques que tu avais déployé pour nous expliquer un des conflits linguistique les plus complexe qui mène ce pays au bord de la rupture.
Depuis, l’actualité avec la démission, du i-xième gouvernement Letherme, a rendu la lecture de ton papier plus nécessaire que jamais, et c’était avec une vive impatience que je trépignais dans l’attente de lire la suite… et plus encore pour le troisième épisode.
[Impatience qui n’a été occultée qu’un seul instant, par l’attitude inqualifiable de DXO envers ce site, contraignant François à retirer son excellent papier. Je vois que je ne suis pas le seul à envisager de ne pas renouveler ma confiance à DXO et son traitement par dessus la jambe de ses clients sur Mac, d’autant que c’est à partir du premier article de cuk que j’en avais fait l’acquisition, il y a cinq ou six ans. Fermons la parenthèse]
L’Europe des États Nations vibre de toute part.
Il y a vingt ans, Tchèques et Slovaques se sont séparés, et retrouvés sous une même bannière européenne. Lituaniens, Lettons, et Estoniens, en ont fait de même, avec les Finlandais, et leurs voisins Scandinaves dont certains, les Norvégiens, ont préféré vivre leur vie, comme les Islandais qui aujourd’hui ont des velléités d’intégrer l’Union européenne ou la zone Euro.
Il y a quarante ans, à l’échelle individuelle, dans beaucoup de nos pays, les divorces par consentement mutuels étaient impossibles, dans les couples. Au fil du temps ils se sont banalisés, même si c’est toujours un moment douloureux pour les personnes concernés, au point qu’aujourd’hui les procédures se sont encore simplifiées.
Les peuples, les nations sont des organismes vivants, et non figés une fois pour toute dans l’histoire… dans des unions qui furent souvent créées par la conquête et l’usage de la force, parfois forcées par d’autres.
À l’échelle collective, nous devrions apprendre à devenir civilisés. On s’associe, on se dissocie, on fait compte bancaire commun, où au contraire on garde sa monnaie, jusqu’à ce qu’on change d’avis.
À l’exception de la Confédération Hélvétique, qui est, à sa manière, comme une sorte de fractale, une version en miniature de l’Europe, nous vivons désormais dans une maison commune, l’Union Européenne.
Qu’y a-t-il de choquant à ce qu’au fil du temps nous décidions de faire chambre à part, ou au contraire de nous regrouper avec tel ou tel de nos voisin, dans la mesure où désormais nos lois sont pour l’essentiel d’émanation européenne, et que, où que nous allions, ce ne sera jamais bien loin, qu’en tant que citoyen nous restons libres de circuler et de nous installer dans un autre pays de l’Union ?
Le cas Belge, suivi par les consultations en Catalogne ou le référendum d’indépendance écossais au mois d’octobre prochain, préfigurent peut être une reconfiguration du modèle de la construction européenne, moins axés sur une Union technocratique et de gouvernement d’États Nations, et peut être plus fédération de peuples et de territoires coopérant les uns avec les autres, sans volonté d’hégémonie des plus grands sur tous les autres, avec des institutions élues au suffrage universel, comme c’est déjà le cas pour le parlement européen.
Nous vivons dans un monde qui bouge et se recompose tous les jours. Le climat change, les paysages avec, les organisations humaines s’adaptent… il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas des États.
Demain ne ressemblera pas à hier. C’est le sens de la vie.
, le 06.05.2010 à 07:31
Merci Franck pour cette excellent article! J’attendais aveca impatience la suite du premier article et je ne suis pas déçu. D’autant que la qualité rédactionnelle est à la hauteur de la qualité du contenu (élevée).
Il ne me reste plus qu’à attendre la fin de la série..
, le 06.05.2010 à 08:47
La Suisse n’est pas prête à éclater, mais la Belgique, oui, c’est mûr, les belges francophones sont prêts à rejoindre la France. Avec Bruxelles ? Difficile : ils sont cernés par les flamands. Il faut se préparer à un pont aérien. Comme à Berlin en 48. Un problème : le partage des dettes. Écosse, ligue du nord de l’Italie, Catalogne, pays Basque, j’ai déjà découpé Frankreich, par anticipation. La destruction européenne se doit d’affaiblir les états (au profit des financiers : nous avons tout vendu, nous en voyons les effets). Yougoslavie, Irak, même tactique : démembrer, vente à la découpe ; suivons la Tchécoslovaquie. L’empire Austro-Hongrois n’a été achevé qu’en 18.
, le 06.05.2010 à 09:10
Remarquable article. Merci pour ce travail et surtout de nous aider à comprendre la complexité de la situation.
Bravo !
, le 06.05.2010 à 09:12
Remarquable synthèse historique… La suite n’en devient que plus attendue!
, le 06.05.2010 à 09:18
J’ai dévoré ton article comme on lit un bon roman policier. Félicitations, Franck !
, le 06.05.2010 à 09:32
Sur un plan strictement historique, rien à redire, c’est du très beau travail. Au delà d’une saga un peu figée, des éléments nouveaux ont quelque peu changé la donne historique de la Belgique. Le mouvement de balancier économique entre les deux communautés est actuellement en faveur de la Flandre suite au déclin de la sidérurgie avec pour conséquence des flux financiers nord-sud, la situation s’est donc inversée. L’extrémisme flamingant joue de cette nouvelle donne pour galvaniser ses électeurs, jeunes en grande majorité se gardant bien de rappeler certains faits historiques.Il est assez facile de jouer la carte démagogique du wallon paresseux profitant de l’économie florissante de Flandre. Une autre réalité est l’affirmation de la langue “flamande” liée au droit du sol, un phénomène inexistant en Wallonie.Paradoxalement, la jeunesse flamande apprend et parle de plus en plus souvent l’anglais. La chanson flamande devient de plus en plus anglo-saxonne. Il faut le dire, la chanson en langue flamande s’exporte mal. Au concours Eurovision, l’artiste flamand chante essentiellement en anglais ! Pour compléter ce paradoxe, la jeunesse flamande déplore le manque d’intérêt des wallons pour sa culture et sa langue…allez vous y retrouver. Les chantres de l’unité du pays sont, par contre, plus nombreux ou plus bruyants en Wallonie. …etc..
, le 06.05.2010 à 09:34
@Kermovan: les belges francophones sont prêts à rejoindre la France: C’est un sentiment qui n’est partagé que par une très petite minorité (dont certains membres sont assez connus en France, comme Philippe Geluck).
@Frank: pour l’aspect linguistique, j’ai lu quelque chose d’intéressant. La France tire son nom d’une tribu (ou plutôt d’un ensemble de tribus): les Francs. Si on se renseigne sur les Francs, il apparaîtrait qu’ils sont originaires de la région qui correspond aujourd’hui à la Flandre. La langue parlée par les Francs était à la base de le francique (qui regroupe un ensemble de dialectes germaniques, à la base du néerlandais et du luxembourgeois entre autres) , mais la classe supérieure de cette tribu serait passée au latin (pour progresser dans la hiérarchie romaine? là ce n’est pas clair). En tous cas, il reste des traces de cette influence germanique dans le français moderne: des mots, des sons qui n’existent pas dans les langues latines (“eu”, “u” le “r” et ce qui allait évoluer vers “in”, “an”,…) et aussi des apports grammaticaux. Ceci expliquerait aussi une possible origine de l’importance du français dans l’artistocratie européenne: les Francs ont envahi l’Europe, et même si seule la France a gardé le nom de la tribu, la partie “germanique” était toujours dirigée par des Francs (le Saint Empire Germanique s’appelait à l’origine: “l’Empire Franc d’Orient”).
Pour ce qui est des communes à facilités francophone/néerlandophone le tableau n’est pas si noir: seules les communes à facilités autour de Bruxelles et les Fourons causent des problèmes, il n’y a rien de comparable dans les communes à facilités situées le long de la frontière linguistique aussi bien dans celles situées en Flandre que dans celles situées en Wallonie.
, le 06.05.2010 à 09:36
Belge expatrié en Suisse depuis plus de 50 ans, j’ai particulièrement apprécié cette synthèse du différent linguistique que j’ai de plus en plus de peine à comprendre, d’autant que j’ai passé toute ma carrière dans une institution internationale où ni la nationalité, ni la langue parlée n’avait d’importance et mon premier patron était néerlandais !
Mais il ne faut pas oublier que ce différent linguistique est aussi le résultat d’une “antipathie” flamande à l’égard de la France tout aussi historique. Je te mets ci-dessous un début d’explication que j’ai donnée à un ami “pur suisse” qui avait de la peine à comprendre la situation belge.
Effectivement, les bagarres Flamands vs Francophones datent d’il y a bien longtemps. En fait, on peut remonter au 13e siècle (La Flandre était vassale de la France – Comté de Flandre – Comté d’Artois), mais avait des liens commerciaux très forts avec l’Angleterre qui comme tu le sais à cette époque déjà était *l’ennemi traditionnel”. Et en 1302, les milices flamandes infligent une déculottée au roi de France à Courtrai dans une bataille qu’on appelle encore “La bataille des Eperons d’Or” parce que la chevalerie française y a laissé tous ses éperons. Cette bataille est toujours célébrée en Flandre, non pas comme une manifestation folklorique comme notre Escalade, mais vraiment comme l’expression de la suprématie flamande sur les “fransquillons”, un peu comme les manifestations orangistes en Irlande. C’est l’occasion pour l’extrême droite flamande de réunir tous ses partisans.
Quelques années plus tard, les Français seront définitivement éliminés de Flandre grâce à Jacques Van Artevelde avec un massacre à Gand qui n’a rien à envier à la St Barthélemy française. Il profite ainsi de la suprématie anglaise qui s’installe sur le continent pendant la Guerre de Cent Ans qui ne prendra fin qu’avec Jeanne d’Arc.
Mais on ne s’arrête pas là : c’est ensuite l’émergence du duché de Bourgogne réuni au Comté de Flandre avec les épisodes Philippe le Bon + son fils, Charles le Téméraire (ça c’est connu chez nous) contre Louis XI. A la mort de Charles, Louis XI espérait bien récupérer la Flandre en plus de la Bourgogne, mais manque de pot, l’héritière a épousé Maximilien d’Autriche et l’Autriche, c’est un trop gros morceau pour la France.
Puis cela continue. : le grand ennemi un peu plus tard, c’est l’Espagne et Charles-Quint et coucou qui est Charles-Quint : à l’origine, le petit… comte de Flandre et duc du Brabant. Sa mère étant infante d’Espagne, le voici propulsé sur le trône espagnol et en plus élu empereur du St Empire au grand dam de François Ier, son concurrent évincé.
On pourrait continuer comme cela tout au long de l’histoire jusqu’aux temps modernes, _
, le 06.05.2010 à 10:21
@ Iker : la Belgique n’est pas encore « mûre » pour la séparation. Les esprits le sont peut-être (pas sûr), mais la réalité économique et politique est là pour les rappeler à l’ordre. Même la N-VA, le parti nationaliste flamand le plus important actuellement, ne programme pas l’indépendance flamande pour le court terme. De cela aussi, je reparlerai.
@ Hervé : avec le recul, la récupération par l’extrême-droite flamingante de la bataille des Éperons d’or, comme symbole de leur lutte linguistique est assez comique, quand on pense qu’un des chefs de l’armée flamande était le comte Jean de… Namur et qu’il avait amené avec lui des troupes du Namurois. En plus, de l’autre côté, il y avait des mercenaires brabançons, au service des Français.
C’est comme le pélerinage de l’Yser, lui aussi récupéré par l’extrême-droite flamingante, qui repose à l’origine sur la supposée découvertes de deux frères, les Van Raemdonck, soldats flamands, qui seraient morts dans les bras l’un de l’autre. En fait il s’est avéré que l’un d’entre eux était mort dans les bras d’un soldat… wallon, Amé Fiévez. Notez comme le nom de ce dernier a été presque complètement effacé sur leur pierre tombale commune…
@ Emile : j’aurais dû parler en effet dans cet article de l’évolution économique différente de la Wallonie et de la Flandre. Je vais essayer de réparer cet oubli dans le dernier article.
@ Reno : bien d’accord sur le fait que la plupart des Belges francophones sont loin, très loin d’être francophiles… Quant aux Francs, on peut noter que Clovis était justement de Tournai. Quant à leur « latinisation » dans la future France et la future Belgique francophone, je pense qu’elle est due à deux facteurs : la présence importante d’une population gallo-romaine latinisée d’une part, et d’autre part à l’influence de l’Église, après la conversion de Clovis notamment. Les évêques représentaient une force politique très importante à l’époque, qu’on a peut-être du mal à imaginer aujourd’hui.
S’agissant des communes à facilités, il y a aussi des problèmes, même s’ils sont moindres, pour les communes concernées le long de la limite entre la Flandre et la Wallonie. Je pense en particulier à Renaix/Ronse, qui a demandé officiellement l’année dernière la suppression de ses facilités (démarche purement symbolique, c’est au niveau fédéral d’en décider) et à Enghien/Edingen, dont la bourgmestre voudrait les voir liées à des moyens financiers supplémentaires qu’elle disait ne pas avoir. Mais j’en reparlerai…
@ tous : merci pour les compliments !
, le 06.05.2010 à 10:31
Miam !
C’est bon, vite une troisième tranche !
Bravo et merci, Franck.
, le 06.05.2010 à 10:57
Excellents articles, et permettez moi d’ajouter quelques réflexions. Car dans cette discorde entre les 2 communautés, il y a de la haine dont l’origine remonte, ente autre, à la bataille de l’yser. A cette époque les officiers donnaient les ordres en français à la “bleusaille” qui elle était issue des provinces flamandes. Et il y eut de nombreux morts par le fait que les ordres n’avaient pas été compris. Tous les ans, à Diksmude ou est érigé une énorme tour, se déroule une cérémonie du souvenir, et il ne fait pas bon être wallon ce jour là. Par contre pas de haine vis à vis des français. Une autre raison de la bagarre entre les 2 communautés vient de l’époque ou toute l’industrie se trouvait en wallonie. La sidérurgie, les mines, le verre, etc. Là aussi, on ne parlait que le français, et les taches pénibles revenaient aux ouvriers flamands, qui y travaillaient vu qu’à l’époque la cote belge n’était peuplée que de quelques villages de pécheurs. Le retour de bâton a eu lieu au moment des avancées sociales, avec les congés payés, puis aussi le tourisme, et les industries. Les villes côtières se sont développées, comme Ostende, puis Knocke qui est le Deauville belge. Entre ces villes plein de petits villages sont devenus de sympathiques stations balnéaires et plein de camping ont vus le jour. Là aussi, j’ai connu à Blankenberghe un camping qui ne refusait une place à une belge wallon. Et personne n’y trouvait à redire. J’ai connu aussi un ami français qui a voulu mettre son bateau au port de Niewport. Les belges (wallon) lui disaient que l’attente était pour eux de plusieurs années. Il a fait sa demande et a eu sa place en 48 heures. Maintenant en wallonie il n’y a quasiment plus d’industrie. Des villes comme Mons ou Charleroi se relèvent péniblement des fermetures des aciéries. Par contre sur la cote belge, on sent et l’on voit que la crise les touche bien moins. Le port de Zeebruge n’arrête pas de s’étendre, et ce qui était il y a une génération qu’un petit port de pèche est maintenant un énorme port à container, et un leader dans la réception des voitures venant du monde entier. D’ailleurs son succès vient aussi des différentes grèves, des dockers, qui ont eu lieu en France à Dunkerque par exemple, ou le port est sinistré, alors que 50 kms plus loin Zeebruge est de plus en plus étendu. Tout cela, je l’ai vu et vécu. J’ai 62 ans, et des amis en Flandres comme en Wallonie. Et ces faits viennent compliquer encore plus les problèmes de la Belgique, mais je pourrai écrire des pages sur cette situation. Une dernière chose que je fais remarquer à mes amis belges. C’est qu’ils sont aussi en train de perdre leur langue. J’ai des amis flamands qui mettent de plus en plus de mots anglais dans leur conversation, en flamand comme en français. Un computer pour ordinateur. Tous les 4×4 sont des Jeeps, même si c’est un Toyota, Etc. Il y a une simplification, par le bas, du langage. Dramatique. Habitant Lille, je regarde souvent la RTB. Et je suis atterré par la déformation de la langue française par des commentateurs. L’un d’entre eux d’origine espagnole je pense, les belges le reconnaîtront, a un accent impossible et déforme les mots au point que je mets une seconde ou deux à comprendre ce qu’il vient de dire. Par exemple les wallons ne font plus la cuisine, ils font la “couisine”. Eh oui, il prononcent comme ci il y avait un “o”. Et j’ai plein d’autres exemples hélas plus facile à prononcer qu’à écrire. Mais le plus beau, et je m’en sers lorsqu’un wallon est sceptique sur le fait qu’il prononce mal les mots, est le suivant. C’est un commentateur de la RTB qui expliquait par rapport à des incendies qui avaient eu lieu en Grèce que des personnes étaient décédées parce qu’elle n’avaient pas eu le temps de s’enfuir. Mais il prononçait ’s’enfouir’ ! Alors ont elles tentées de s’échapper ou de s’enterrer ? Voilà, peut être, tout le paradoxe belge.
Merci de m’avoir lu.
, le 06.05.2010 à 11:03
À noter qu’il en va de même pour l’événement choisi pour la fête correspondante de la communauté française: l’expulsion des troupes hollandaises de la ville de Bruxelles. À cette période, Bruxelles était une ville néerlandophone…
, le 06.05.2010 à 11:18
Et pourtant dans la crypte de la tour de l’Yser se trouve enterré le Wallon Amé Fiévez avec les frères Van Raemdonck. J’en parle un peu plus haut dans les commentaires.
Ce n’est pas dû à une dégénérescence du français de Belgique. Ils ont toujours prononcé le « ui » comme cela, et continueront sans doute à le faire. Moi-même, je me surprends à le faire de plus en plus souvent, sous l’influence de mon entourage, en particulier ma compagne, une Bruxelloise ;-) Autre exemple : le nom de la ville de Huy, qui se prononce « oui ».
Par contre, le Belge francophone sait très bien faire la différence entre les deux nasales « in » et « un ». Les mots « brin » et « brun » sont prononcés très distinctement ici en Belgique, tandis qu’en France c’est devenu quasiment la même chose.
Quant à l’invasion des termes anglais, je l’ai aussi constatée. Autre exemple : ici, on ne fait pas ses courses, on fait du shopping. Mais qu’y faire ? Comme tu l’as dit, c’est toute la Belgique qui est atteinte, la Flandre aussi. Et ça ne va pas aller en s’arrangeant, m’est avis.
, le 06.05.2010 à 11:33
Plein de commentaires sont arrivés pendant que j’écrivais ma longue tirade.
Ce qui explique les commentaires en double.
Une autre anecdote “pour la route”. Je pense que c’est en 1966, je faisais partie des personnes qui ont suivis la visite du Général de Gaulle en Belgique. Le premier jour à Gand, en Flandres. Le deuxième à Liége avec une arrivée en train. Le troisième à Bruxelles. Et lors du discours de liége, un homme a crié “Liége rattachement à la France”. Il a été évacué vite fait. La presse en a parlé un peu. Comme vous voyez le problème n’est pas nouveau.
Bonne journée à tous.
, le 06.05.2010 à 12:04
Bof, la francophobie est un sport international très en vogue (e.g. le boycott des marques françaises aux Etats-Unis, en Chine, …) et il existe même beaucoup de francophobe francophone (e.g. le “connard de frouze”, le “maudits Français”). D’ailleurs, avec le temps je suis devenu un peu blasé sur ce plan…
Par exemple, je ne suis même pas étonné le jour ou une collègue Suisse allemande et docteur en microbiologie m’a demander qui était Pasteur. En fait, elle n’en avait jamais entendu parler durant ses études en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis, alors qu’à la base les microbes… Il y a aussi un collègue suisse romand qui m’a soutenu que Daladier était à l’origine de la politique d’apaisement avec Hitler en 38, et que de Gaulle avait pris le pouvoir par un coup d’état en 58… et le plus intéressant c’est qu’il aurait appris tout ça à l’école. Quoi qu’il en soit, lorsque l’on entend une de ces blagues sur les “gaulois” qui circule en Suisse et en Belgique, il ne faut surtout pas relever le détail mesquin selon lequel les Helvètes et les Belges auraient été (dans la limite des tolérances douanières) des tribus gauloises, car sinon on passe pour un français et il n’est pas possible de vivre avec une telle honte !
Donc, si le wallon partage des points communs avec le français, alors il a tout les vices et aucune qualité. C’est comme ça, c’est une loi universelle, point. ;-)
, le 06.05.2010 à 12:10
Mon cher Droopy, la prononciation des mots est vraiment propre à chaque région : le parler chti ou provençal n’est pas le même. Et donc, la Belgique a aussi son parler, qui peut d’ailleurs différer de Charleroi à Liège.
Ainsi, en arrivant en Suisse, j’ai passé une première fête de “Nowel” chez des amis et pour l’occasion, j’avais mis une “propre chemise”.
J’ai longtemps, et encore souvent maintenant (ma femme – genevoise – se fait un plaisir de me faire remarquer que je redeviens belge) dit “houit” (8), mais je me marre toujours quand un français parle de Cruif (comme «suif»), footballeur néerlandais bien connu alors que son nom se prononce “Creuif” comme “feuille”
Ce qui est un défaut pour les uns n’est que la normale pour les autres
, le 06.05.2010 à 12:16
Citation de Hervé
Mon cher Droopy, la prononciation des mots est vraiment propre à chaque région
Peut être, mais lorsque le même mot prononcé différemment ne veut plus dire la même chose, comme s’enfuir et s’enfouir. Cela pose problème à la bonne compréhension de la phrase
, le 06.05.2010 à 12:24
Petite nuance : ce sont des celtes, comme les irlandais, les écossais etc. Du temps de César, de nombreuses tribus cohabitaient sur le territoire que César a baptisé la Gaule pour simplifier. Et sa première raclée, ce n’est pas Vercingetorix qui lui a infligée à Gergovie, mais Boduognat (Nerviens installés dans ce qui est le Hainaut actuel) à la bataille de la Sambre (avec l’aide d’Ambiorix, Eburon du Namurois).
D’ailleurs “Horum omnium, fortissimi sunt Belgae…” C’est lui qui l’a dit :-))
, le 06.05.2010 à 12:27
Pil poil…
Je me demandais bien où tu voulais en venir avec ta longue tirade pleine de compassion et d’analogies alambiquées… je te recommande une petite étude génétique sur les Basques et leur soi-disant revendication de peuple “unique” qui justifie pleinement le droit d’être indépendant (quelle blague).
Si le premier fléau pour la progression de l’humanité reste les religions, le second qui n’a rien à lui envier est bien dans cette revendication à la con d’une langue, d’une région ou d’une frontière imaginaire sur une carte…
Tous ces problèmes d’ego et de nombril montrent à quel point nous sommes encore primitifs.
T
, le 06.05.2010 à 13:39
Je suppose que tu inclus dans ces “primitifs” tous les Jurassiens qui ont voté la séparation avec Berne en 1974 ?
, le 06.05.2010 à 13:51
Point besoin d’aller si loin pour trouver le “houit”… Il n’est qu’à aller à Fribourg !
P.
, le 06.05.2010 à 14:03
@Hervé n’empêche que les romains et les germains étaient déjà gallophobes ;-)
, le 06.05.2010 à 14:07
CHD : En fait de “phobe”, se référer à Coluche !
, le 06.05.2010 à 14:35
Ça ne s’arrange pas aujourd’hui, quand j’entends mes chers compatriotes Français prononcer le nom de Tom Boonen (le principal coureur cycliste belge du moment). Ils disent « Bounènn » alors que cela se prononce comme cela s’écrit, avec un « o » allongé et un « e » sans accent. De la part d’une personne lambda, ce genre d’erreur ne me choque pas. Mais quand ça vient des journalistes sportifs, qui sont quand même bien placés pour demander à qui de droit comment cela se prononce, c’est quand même surprenant !
Le pompon, c’était quand ils devaient prononcer « Johan Museeuw », autre cycliste belge fameux retraité il y a quelques années. Ça se prononce à peu près « Yohann Musséou ». Mais pour ce nom-là, j’aurais entendu toutes les variantes de la part des journalistes hexagonaux : Mussé, Moussé, Muzé, Mousseux, Mussau, etc.
Petit test pour les non-Belges qui me lisent : comment prononcez-vous le nom « Poelaert » ? ;)
, le 06.05.2010 à 14:42
“de tous les peuples de la gaule les belges sont les plus braves” la phrase n’est pas complète car il a ajouté:” et les plus téméraires” et là César il me fend le coeur…
, le 06.05.2010 à 14:45
SVP, évitez “Poélaërt” et rappelez-vous la guerre des Boères :-))
, le 06.05.2010 à 14:54
@fxc Soyons honnêtes : il fallait qu’il jusitifie face à son opinion publique le fait que Labienus s’était fait tailler des croupières par Boduognat et qu’il avait donc besoin de renforts et de sous . Les Belges avaient des armes de destruction massive !
, le 06.05.2010 à 16:15
Je préfère : comment prononcez-vous le nom « Hoegaarden » ?
, le 06.05.2010 à 16:22
et le traité de Maastricht, cette ville hollandaise, dont la prononciation française est à mourir de rire.
, le 06.05.2010 à 16:33
“Hoegaarden” en Suisse Romande, ça se prononce “Cardinal”. Mais c’est pas tout à fait la même chose :-((
, le 06.05.2010 à 16:39
Visiblement, il y a encore des connections à Internet en Grèce.
Oui, faire des combats pour des langues, des frontières et des religions est primitif.
T
, le 06.05.2010 à 16:59
TTE
Version courte
Ce serait bien de lire les textes avant de les commenter, et m’attribuer des propos que je n’ai pas tenus. Mes contributions, parfois anciennes, sur le sujet, démentent toutes les intentions que tu me prêtes.
Jusqu’à maintenant la conversation était éclairée et courtoise. Un modèle d’intelligence collective.
Le premier fléau de l’humanité c’est d’exprimer à l’autre “tes convictions sont fausses, seules les miennes comptent, et comme je n’ai pas envie d’argumenter et je vais te les imposer par l’invective ou par la force”.
Tu l’as dit bouffi
•••• Version argumentée
J’ai lu l’article dans le journal Publico le 19 février dernier, merci. De mémoire, avec un échantillon d’une trentaine de personnes du Pays Basque, comparé avec autant de personnes dans neuf autres régions de la péninsule ibérique… Publico est un journal dont les enquêtes sont aussi fouillées que celles de “Metro” ou “20 minutes”. Sur le moment ça m’a fait penser à ces organismes censés mesurer les sentiments profonds de l’opinion publique sur la crise par exemple en se livrant à un micro-trottoir sur l’Avenue Montaigne ou les Champs Élysée, à la sortie des chaînes de télévision ou de radio.
J’attend avec impatience la lecture des résultats dans “Nature” ou “Science”. Juste pour ma culture générale.
En attendant, cet article m’a aussi distrait que la lecture de l’horoscope ou une conversation de comptoir.
Ça tombe bien :
• pour une fois je n’en ai pas parlé des basques, c’est ton vieux camarade Kermorvan qui l’a fait ;-)
• au cœur de l’Europe, nous sommes tous des peuples métissés, et donc l’hypothèse génétique n’est intéressante que d’un point de vue anthropologique, pour décrire un monde qui n’existe plus au même titre qu’on peut se pencher sur dinosaures… et personnellement je n’ai pas une passion démesurée pour la paléonthologie ;
• Ceux qui ont envisagé cette hypothèse pour lui donner un corps politique l’ont fait en 1895, à une époque où le concept de race était à la mode chez tous les hommes politiques du moment, toutes tendances confondues. Depuis, tout le monde sauf quelques simples d’esprits un peu obsessionnels, est passé à autre chose, vu le nombre de crimes et de génocides qu’on a commis au nom de ce concept de race.
• personnellement, j’ai toujours réfuté cette thèse, en particulier lorsqu’il s’agit de s’appuyer dessus pour revendiquer une indépendance ; Il y a d’autres critères qui sont bien plus pertinents pour revendiquer des droits, mais certainement pas la génétique.
• j’en profite pour répéter que je réfute également l’idée même de nationalisme, et je vais te confier un secret, c’est sur CUK et grâce à la bienveillance de ses lecteurs que j’ai peaufiné et rodés mes premiers argumentaires publics pour réfuter cette idée là et qu’aujourd’hui je les développe devant des auditoires de plusieurs centaines de personnes dans des réunions publiques, face notamment à des indépendantistes ou des nationalistes, qui en général en sortent ébranlés. Je devrais remercier beaucoup de contributeurs de CUK, y compris et je dirais même surtout ceux qui essayaient de réfuter mes arguments avec le plus de véhémence, à l’insu de leur plein grès, ils m’ont beaucoup aidé, et ça a eu quelques d’effets sur lesquels il est encore prématuré d’écrire.
• je parle de “communauté des citoyens”, composée de tous les habitants d’un territoire, d’où qu’ils viennent. Je suis moi même un fils d’immigré.
• par ailleurs, TTE, je suis attaché à la notion de droit, en particulier des droits universels. “Le droit à l’autodétermination” est un droit reconnu par tous les traités internationaux et s’impose sur les droits des États et des individus qui pensent comme toi que ce n’est pas important.
• ça ne veut pas dire que lorsqu’on se détermine, on doive nécessairement le faire en choisissant l’indépendance. Le droit au mariage ou au divorce existe, il n’est pas une obligation, ce doit être une liberté, inaliénable, en fonction des circonstances. Il en est de même pour les peuples.
• ma position sur l’indépendance est simple : c’est un principe éphémère apparue véritablement au XVIIIe siècle, qui a pris corps notamment à travers l’indépendance de la Corse, vite reconquise, des États Unis et d’Haïti… cette idée s’est répandue comme une traînée de poudre tout au long du XIXe et du XXe siècle, pour sombrer corps et biens dans les décolonisations purement formelles des années 50/60.
• en tant qu’observateur de la vie politique, on ne peut pas exclure que des territoires accèdent encore à l’indépendance y compris en Europe occidentale. Les Flamands, les Catalans et les Écossais mettent cette question à l’ordre du jour d’une manière ou d’une autre cette année soit par le biais de consultations ou de référendums, soit par des crises politiques qui font chuter des gouvernements fédéraux. Ça c’est ce que j’observe. Ce sont des faits.
• en tant qu’acteur politique, par contre, je pense que c’est trop tard, il me semble que ça ne se fera pas, en particulier pour le Pays Basque, sauf si la crise précipitait les États Européens, dans les vieilles tentations hégémoniques des États centraux traditionnels (pour faire bref, les anciennes puissances : la France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne…)
Peut être que les faits me donneront tort… en particulier par les temps troublés que nous traversons avec la profondeur de la crise dont nous ne sommes encore qu’aux premières étapes, et qui distend les relations de solidarité entre les peuples ; La confusion qui pourrait sortir du vote britannique d’aujourd’hui, par exemple, pourrait me contredire. L’hypothèse d’une victoire des conservateurs sensiblement minoritaires en voix, mais majoritaires du fait du mode de scrutin des britanniques [pour le coup alambiqué] provoquerait un raidissement des parlementaires anglais, et précipiterait la radicalisation des Écossais dans le référendum d’indépendance d’octobre prochain.
• dans mon engagement, je fais le pari du contraire, que l’intelligence et les solidarités primeront sur les tentations de repli derrière des frontières plus fictives que réelles ;
• car les indépendances les plus récentes sont purement formelles, au point que même un État comme la Suisse qui n’appartient pas à l’Union Européenne, voit sa souveraineté mise à mal, sur la question bancaire par exemple par la communauté internationale. Nous sommes, et c’est un truisme de le dire, dans des mondes interdépendants, une économie mondialisée, où ce qui s’est passé au fin fond de l’Ohio ou de la Californie, a directement affecté, quasiment instantanément l’emploi des financiers britanniques, le logement du jeune travailleur andalous, ou la retraite par capitalisation des classes moyennes y compris helvétiques
• j’irais jusqu’à dire que plus l’idée d’indépendance formelle recule, que les frontières s’estompent, plus la notion d’empowerment, d’autonomisation des territoires, est nécessaire, pour faire contrepoids à des gouvernements physiquement éloignés comme l’Union Européenne.
C’est la notion de pouvoirs et de contre-pouvoirs, de “check and balances”.
, le 06.05.2010 à 17:28
Mmmhhh… les interventions louaient le camarade F qui a fait un très bon boulot, je l’ai aussi dit en première partie. Le lien que je donne fait référence à une étude scientifique et c’est le CI qui en publie un résumé… je n’ai pas l’impression que le Publico ait des journalistes généticiens dans ses rangs… d’ailleurs, dire journaliste c’est déjà une grosse escroquerie de nos jours.
Bref, divorcer à l’amiable est quelque chose de “normal” à l’échelle de 2 personnes… vouloir partager un pays en deux parce que deux communautés ne s’entendent plus à cause de leaders politiques qui exacerbent les tensions, c’est un autre problème à mon humble avis.
Si demain des politiciens voulaient l’autonomie de la Romandie en tant que nation, je trouverais ça tout aussi primitif.
Notre salut viendra de savoir vivre ensemble, pas de vivre séparément ou reclus sur soi-même.
T
, le 06.05.2010 à 19:42
J’ai enfin pu lire ton article (vous comprendrez demain).
Un seul mot Franck, merci!
, le 06.05.2010 à 20:21
TTE
Il y a des cantons mixtes, comme Berne, Fribourg ou le Valais me semble-t-il.
Il me semblait que les cantons de Vaud, Genève, du Jura, de Neuchâtel ont déjà leur autonomie, une des plus avancée d’Europe même ? et que ton pays n’était constitué que d’autonomies. C’est un État fédéral non ? vous avez changé de régime depuis un an ? ça m’avait échappé ! ;->
, le 06.05.2010 à 20:41
Ramener les désirs d’autonomie, voire d’indépendance uniquement à des questions génétiques, religieuses ou linguistiques, c’est avoir une bonne méconnaissance historique. Je ne parlerai pas de la Belgique pour ne pas interférer sur le prochain article de Frank, mais prenons un autre exemple assez proche de nous : l’Irlande.
Pas de problème génétique : les Irlandais, Ecossais et Anglais ne diffèrent guère génétiquement.
La langue : c’est vrai que le gaélique est encore présent, mais n’a pas été une cause de la scission.
La religion : c’est celle qu’on invoque le plus souvent et peut-être s’applique-t-elle encore à la partie Nord.
Mais ce qui a motivé la longue lutte irlandaise pour une indépendance obtenue en 1929, c’est : – les petits massacres de Cromwell au 17e siècle
– les spoliations des terres au 18e siècle
– la grande famine du 19e siècle provoquée par les réquisitions anglaises
Quand un peuple se sent brimé, spolié (matériellement ou culturellement), il devient vite “primitif”
, le 06.05.2010 à 22:31
D’abord, ce n’est pas vraiment mon pays même si techniquement parlant, c’est un de mes passeports. Toutefois, dans mon âme ou esprit, j’y vis, c’est tout. Je me sens plus proche du “monde” que d’un pays.
Mais je te rassure, le régime de ce pays n’a pas changé alors qu’il faudrait ou qu’il aurait tout intérêt à changer! Aujourd’hui, les cantons se font une guerre économique stupide et complètement contre productive. Je ne parle même pas des milliers d’emplois qui sont à double ou triple…
On ne remerciera jamais assez les anciens pour éduquer cette jeunesse décérébrée et totalement inculte.
Les Bernois ont envahi Vaud il y a plus de 200 ans… j’imagine qu’il y a eu quelques morts et quelques problèmes… et alors? Est-ce que ça voudrait dire qu’aujourd’hui ces deux cantons ne pourraient pas fusionner? Est-ce que ça voudrait dire qu’il faut crever les pneus de toutes les voitures bernoises qu’on croise en ville? Et la fusion de Vaud-Genève, pourquoi est-ce qu’elle n’aurait pas de sens?
J’avais écrit sur le sujet en 2004 et pour moi, dans ce genre de conflit linguistique, on ferait bien mieux d’imposer une langue étrangère comme l’Anglais ou même le Chinois au niveau national tout en gardant régionalement les langues locales plutôt que de vouloir forcer une ou plusieurs langues régionales aux autres.
Mais voyons ce qui va arriver dans le troisième volet de cette aventure… pour voir à quel point on peut être primitif pour des raisons qui me dépassent complètement mais qui au niveau électoral valent assurément leur pesant de cacahuètes…
T
, le 06.05.2010 à 22:48
@ TTE Décidément tu ne te départiras jamais de ton grand amour pour moi :-))
Alors, laisse à l’ancien le soin de t’apprendre quelque chose sur TON histoire (pas la mienne) : Les Bernois n’ont pas envahi le canton de Vaud il y a 200 ans, mais ils l’ont piqué au Duc de Savoie avec l’aide de la France en 1536, soit presque 500 ans. Il y a environ 300 ans, ce fut l’épisode du Major Davel (un vrai primitif celui-là) et il y a 212 ans, Vaud devenait enfin primitif en se libérant de la tutelle bernoise, grâce à Napoléon, encore Buonaparte.
Mais je connais MON histoire de Belgique un peu mieux que tu connais la tienne et le conflit Wallons-Flamands n’a pas uniquement une source linguistique, comme a essayé de le dire Verschueren et d’autres et que Franck a, lui, parfaitement compris.
, le 06.05.2010 à 22:54
A coté de cela BHV* c’est de la r…. de sansonnets
*BHv ne veut pas dire bazar de l’hotel de ville mais bien ” Bruxelles, Halles, Vilvorde” et là c’est vraiment le bazar.
, le 06.05.2010 à 23:02
Quand j’étais encore en Belgique, le b…azar (on reste poli sur cuk), c’étaient les Fourons ! Pas loin de chez toi, si je ne m’abuse !
, le 07.05.2010 à 00:08
Remets tes lunettes ou arrête de respirer des gaz lacrymogènes, j’ai dit plus de 200 ans. J’ai cité cette date uniquement comme référentiel par rapport à la création du canton… je sais que ça remonte avant ta naissance mais il y a eu un épisode dramatique entre Vaud et Berne. Figure toi que j’ai gardé un bouquin d’histoire sur Vaud qui m’a été remis en 1991… je cite:
—–—–——-Le Pays de Vaud était stratégiquement important ; les Confédérés voulurent stopper le transit des troupes italiennes qui traversaient les Alpes pour rejoindre l’armée de Charles. Ils s’attaquèrent d’abord aux possessions d’une famille bourguignonne vassale de la Savoie, les Chalon-Orange et s’emparèrent de Grandson, d’Orbe, de Montagny et d’Echallens en avril 1475. A l’est, les troupes bernoises mirent la main sur Aigle et sur une partie du Chablais.
Une nouvelle conquête du Pays de Vaud: En octobre 1475, les Confédérés déclarèrent la guerre à Jacques de Savoie, massacrèrent les garnisons des Clées et de La Sarraz qui avaient résisté, et occupèrent les autres bourgs vaudois qui capitulèrent avant d’avoir été attaqués. Au début de 1475, Jacques de Savoie réussit à reprendre le Pays de Vaud aux occupants.
Mais les défaites décisives de Charles le Téméraire à Grandson (février 1476) et Morat (juin 1476) entraînèrent une nouvelle conquête du Pays de Vaud. Le pays tout entier fut dévasté et les vainqueurs le rançonnèrent lourdement. La duchesse de Savoie s’était rapprochée du Téméraire, décision lourde de conséquences. Les Bernois toutefois ne purent obtenir ce qu’ils demandaient, – l’entier du Pays de Vaud, le Chablais et Genève -, leurs Confédérés ne désirant pas voir grandir la puissance bernoise et Louis XI protégeant les intérêts de son neveu le duc de Savoie. La duchesse Yolande récupéra contre une forte rançon le Pays de Vaud. Berne conserva une partie de ses conquêtes, les mandements d’Aigle, d’Ollon, de Bex et des Ormonts. Avec Fribourg, elle garda Orbe, Echallens, Montagny-sur-Yverdon, Grandson et Morat qui devinrent des bailliages communs des deux cantons suisses
Ainsi donc, les guerres de Bourgogne, qui marquèrent pour les Cantons suisses l’apogée de leur gloire militaire et le début d’une politique européenne, furent pour les ducs de Savoie un coup fatal porté à leurs possessions au nord du Léman et pour les habitants du Pays de Vaud synonymes de désolation et de ruines. Bien plus, elles furent pour les Bernois et les Fribourgeois l’occasion de s’implanter au cœur du pays.
—–—–——-Désolé à F d’avoir un peu pourri les commentaires… mais Hervé traverse une phase difficile en Grèce…
T
, le 07.05.2010 à 07:12
Ce qui a pourri les commentaires c’est
Et ta parfaite connaissance des problèmes communautaires belges ! Sans oublier les Thibétains, Catalans, Kosovars et ces primitifs Ukrainiens, Biélorusses et Géorgiens (et j’en passe) qui ont quitté la Sainte Russie. Quant aux Israéliens et Palestiniens, ils n’ont qu’à tous devenir bouddhistes et parler chinois et le problème sera résolu.
, le 07.05.2010 à 10:12
Quel réalisme, comparé des pays en guerre (au sens littéral) avec la Belgique actuelle…
T
, le 07.05.2010 à 10:26
Je vais m’adresser à toi, Franck, mais aussi à vous tous (forcément !). Ce qui explique ce mélange hasardeux de “tu” et de “vous”. Je vous demande d’avance de me pardonner pour cet “effet de style”…
Tout d’abord, je veux saluer, comme d’autres ici, les qualités de ton article, notamment une rédaction soignée et une très bonne lisibilité. Mais, tu le soulignes toi-même, il est bref et ne peut être complet.
J’aimerais y faire quelques ajouts qui je l’espère éclaireront, si c’est possible, le débat.
Tout d’abord j’aimerais préciser que ce que Jules César appelait Gallia Belgica s’étendait au sud d’une ligne allant de Boulogne à Cologne (cette ligne que tu indique sur la première carte qui illustre ton article et qui passait par Bavais et qui suit assez fidèlement et à quelques exceptions près l’actuelle frontière linguistique). Au nord de cette ligne, Jules nous dit que c’est la “Germania Inferior”. L’histoire commune des peuples actuels de la Belgique ne commence donc pas à cette époque.
Plus tard, tu l’indiques avec raison, les comtés, duché et principauté divers continuent de se situer de part et d’autre de cette même ligne. Toujours pas d’histoire commune.
La première “unification” se fait par la force sous l’occupation espagnole. A cette époque l’élite s’exprime plutôt en latin qui est la langue véhiculaire de l’époque, comme l’anglais aujourd’hui. Depuis le moyen âge, les noms propres sont latinisés (Erasme : Desiderius Erasmus Roterodamus, Gehrard Kremer : Mercator, Andries van Wesel : Andreas Vesalius (André Vésale), etc…) et pendant la Renaissance, c’est le français (un français que nous pouvons à peu près lire, mais qui, si l’on nous le parlait comme à cette époque, nous serait la plupart du temps incompréhensible) qui prend le relais.
Plus tard, comme tu le dis, les Français créent les provinces.
Tu soulignes fort justement l’échec de Guillaume d’Orange à unifier, en 1815, son pays avec ce qui deviendra, pas plus de 15 ans plus tard, la Belgique. Pour des raisons politiques et religieuses, les “Belges” s’unissent pour bouter le Hollandais au nord (avec une aide substantielle des Français, il faut le dire !).
C’est là qu’intervient un événement dont tu ne parles pas et qui est, à mon sens, primordial : la Conférence de Londres. Là, se réunissent les grandes puissances de l’époque (Royaume-Uni, Autriche-Hongrie, Prusse, Russie et France) qui décideront du sort des provinces qui se sont exclues des Pays-Bas. En 1831, un premier traité sortira de cette conférence : le “Traité des XVIII Articles” qui est refusé par Guillaume d’Orange car il exclut des Pays-Bas le Limbourg et le Luxembourg qui sont intégrés à la future Belgique.
Je vous épargne les épisodes concernant le choix du souverain. Il y eut, en effet, plusieurs candidats. L’homme providentiel est trouvé en la personne de Léopold de Saxe-Cobourg Gotha, candidat des Anglais. Il est finalement choisi à condition qu’il épouse la fille de Louis-Philippe, Roi de France. Anecdote : pour pouvoir épouser Louise d’Orléans (et devenir, accessoirement, roi des Belges), Leopold Georg Christian Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf de l’héritière du trône d’Angleterre morte en couche, doit divorcer d’une actrice, Karoline Bauer, qu’il a épousé en secret ! Ce prince réunit bien des atouts : il est allemand, né à Cobourg, en Bavière, il a servi le Tsar (Léopold a été nommé colonel de l’armée impériale à 5 ans !) car il est le beau-frère du futur potentiel Tsar. Il sera bientôt le gendre du Roi de France. Au moment de son accession au trône de Belgique, il se trouve en Angleterre où, suite à son veuvage royal, il touche une pension non négligeable que la liste civile anglaise se passerait bien de lui verser.
En 1839, un second traité est signé à Londres : le “Traité des XXIV Articles”, qui sort le Limbourg et le Luxembourg de la Belgique pour les réintégrer aux Pays-Bas et indique entre autres que la Belgique sera un État perpétuellement neutre sous la garantie des cinq puissances. Sous ce vocable, les grandes puissances créent en réalité de toutes pièces un état tampon entre les Anglais, les Allemands et les Français qui doit garantir une paix durable… On sait ce qu’il en adviendra ! Étant donnée sa neutralité imperméable (contrairement à celle de la Suisse qui est dite perméable), la petite Belgique sera par trois fois obligée de se défendre devant “l’ogresque” ennemi venu de l’Est. L’Etat tampon se transforme alors en champs de bataille, ce qu’il fût déjà à de nombreuses reprises précédemment (rappelez-vous , entre autres, Waterloo).
Voilà comment est né ce pays improbable qu’est la Belgique.
Pour ce qui est de la suite de l’histoire, tu la racontes très bien.
Un détail cependant : la carte qui montre l’évolution de la frontière linguistique, légendée en Néerlandais, doit provenir de recherches d’origine flamande. Les noms des villes de Wallonie et du Nord de la France sont “flamandisées” (Rijssel pour Lille, par exemple). Cela n’augure pas d’une grande objectivité. D’autre part elle n’est pas très lisible, pourrais-tu nous en donner la source ? Je trouve que lorsque l’on évoque les lieux bilingues mais à majorité francophone (Tweetalig maar een Franse meerderheid) et qu’on ne mentionne pas les quelques communes des environs de Bruxelles qui sont dans ce cas, ce n’est pas très honnête.
J’attends, comme nombre d’entre nous, la suite de ton article qui tombe à pic puisque la Belgique vit actuellement une crise majeure dont elle aura du mal à se sortir sans de grands bouleversements. Il faut savoir que pour des raisons complexes mais réelles (constitutionnelles), certains magistrats du nord vont très certainement demander l’invalidation des élections qui auront lieu en juin prochain. Et que des bourgmestres flamands vont probablement refuser de les organiser…
Voir :
Le Soir
Ecouter (passez votre souris sur les petits portraits du Premier, c’est du flash) si vous avez 12:45 à y consacrer :
RTBF – La Une
A bientôt,
Daniel.
, le 07.05.2010 à 14:15
J’avais trouvé et téléchargé cette carte sur la version néerlandophone de Wikipédia, il y a déjà un bout de temps. De mémoire on y citait sa source, mais je ne l’ai malheureusement pas conservée (la source). Elle semble ne plus figurer sur Wikipedia, mais je l’ai retrouvée ici (site néerlandais qui défend une autre théorie sur la naissance de la frontière linguistique que celle qui est généralement admise et que j’ai exposée plus haut). Je n’en ai pas trouvé l’auteur.
Cette carte est-elle pour autant discutable ? Je l’ai insérée parce qu’elle correspondait parfaitement à ce que j’avais lu et entendu lire sur le sujet, et qu’elle le mettait bien en image. Notamment sur les poches historiques de bilinguisme éparses de ci – de là autour de la frontière linguistique. De plus, chaque délimitation de la « taalgrens » est associée à un nom précis, notamment celui de Maurits Gysseling, un linguiste reconnu, dont j’avais entendu parler.
Il faut faire attention au fait que cette carte est en fait une sorte de juxtaposition de deux cartes avec deux légendes distinctes. L’une du nord de la France, s’appelle « Evolutie van de taalgrens in Frans Vlaanderen (évolution de la frontière linguistique en Flandre française). Celle-ci s’attache entre autres à recenser les zones effectivement bilingues de cette région. L’autre légende concerne la « evolutie van de taalgrens in België » (évolution de la frontière linguistique en Belgique), et celle-ci décrit non pas la répartition effective actuelle du bilinguisme en Belgique, mais sa répartition « officielle ». Un choix fait pour ménager les susceptibilités ? Ou tout simplement parce que les recensements linguistiques officiels en Belgique sont interdits, sous pression de la Flandre, depuis les années 50-60 ?
Par ailleurs, à peu près toutes mes images viennent de Wikipédia (français ou néerlandais). Merci à lui ! Je compte citer complètement mes autres sources à la fin du troisième article. Je peux déjà dire que les principales sont deux livres, l’un francophone, l’autre néerlandophone (traduit en français) : « Les étonnantes origines de la frontière linguistique », par Jean-Marie Gillet, éd. J.M. Collet, et « Het Belgisch Labyrinth / Le labyrinthe belge, par Geert Van Istendael, éd. « Le Castor Astral » pour la traduction française.
, le 07.05.2010 à 16:41
Depuis la loi de 1963, plus exactement, cette loi qui fixe une bonne fois pour toute cette frontière linguistique et interdit les recensements linguistiques depuis cette date.
Avant, un recensement linguistique avait lieu tous les dix ans et l’on remodelait la frontière linguistique en fonction des résultats. Comme de plus en plus de francophones allaient habiter dans les communes flamandes des environs de Bruxelles, la communauté flamande perdait à chaque fois des morceaux de territoire. Sans cette loi de 1963, les communes à majorité francophone qui entourent aujourd’hui Bruxelles feraient partie de Bruxelles-Capitale qui aurait donc une frontière commune avec la Wallonie. C’est ce que revendiquent actuellement les partis francophones (du moins le déclarent-ils !) dans la négociation sur BHV.
Mais n’anticipons pas trop sur ton article à venir.
Merci pour tes indications bibliographiques. Je vais essayer de trouver ces livres que je connais pas à la bibliothèque municipale, mais j’en doute… J’habite Sète et pour les Sétois, la Belgique c’est dans l’arctique…
, le 07.05.2010 à 18:33
Si le fait que les noms des villes sur une carte soient inscrits dans la langue du document duquel la carte est tirée est un critère de partialité, je pense qu’on peut écarter 99% des cartes publiées dans le monde. As-tu déjà vu beaucoup de cartes en français où Londres est écrit “London”? (pour l’anecdote, il y a aussi une commune flamande dont le nom est Lille).
Cette loi a fixé la frontière linguistique (et l’appartenance exclusive d’une commune à un régime linguistique) sans tenir compte des majorités linguistiques en place. Et en “échange” le concept des facilités a été introduit par cette loi.
, le 07.05.2010 à 19:26
Sur le net, j’en trouve pas mal. Mais dans le cas qui nous occupe c’est une carte de la Belgique avec un petit bout de France et ViaMichelin dit bien Gent, Bruxelles-Brussel, Namur, Lille et London. Ce qui me semble frappé du bon sens. La carte dont nous parlons est destiné à des lecteurs néerlandophones et indique qu’une partie du Nord de la France parle le français et le néerlandais (tweetalig). Moi, je veux bien, mais les quelques anciens qui parle encore un patois plus ou moins proche du néerlandais dans cette contrée, on doit pouvoir les compter sans difficultés avec quelques doigts de quelques mains.
Nous verrons, suite au prochain article de Franck, en quoi consistait l’échange, qui en décidât et ce que sont devenues ces “facilités” de nos jours !
, le 07.05.2010 à 21:43
Sur le net c’est vrai que c’est la règle, mais le net est malheureusement l’exception. Sur les cartes dans la presse écrite, les atlas, la télé, les panneaux routiers, la norme est plutôt de mettre les noms dans la langue du “canal de diffusion” (ça a même d’ailleurs un côté ridicule, je trouve, car en plus ça ne correspond pas toujours à la pratique orale).
Pour ce qui est du dialecte néerlandais en France, ça m’a intrigué, et d’après wikipedia, il y en aurait encore 20000 qui le pratiquent quotidiennement et 40000 occasionnellement. Mais ils étaient encore majoritaires dans les années 70 (date la plus récente indiquée sur la carte), en tous cas pour la préfecture de Dunkerque (ce qui colle avec la carte)
, le 08.05.2010 à 01:12
De tous les peuples de la gaule… Cette citation qui a été remise au gout du jour au moment de l’indépendance de la Belgique est incomplète,… car à l’origine pas aussi élogieuse pour les “belges” que ce que l’on peut penser… Et de belges cités par César, un tiers seulement correspond au territoire occupé actuellement par le royaume de Belgique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Horum_omnium_fortissimi_sunt_Belgae
, le 08.05.2010 à 07:56
Ma citation n’était qu’une boutade, mais les commentaires ne permettent pas d’ajouter des smileys :-D.
, le 09.05.2010 à 19:24
Comme l’a fait remarquer très à propos Droopy plus haut, il manque un chapitre important dans l’histoire de la brouille belge: la première guerre mondiale, qui a permis de montrer que les classes supérieures parlaient français, y compris à des troufions flamands qui n’avaient pas la chance de les comprendre. Une rage vengeresse s’en est suivie, matérialisée par l’érection de la tour de l’Yser, dynamitée par des “vrais belges” après la seconde guerre mondiale, elle-même marquée par une collaboration avec le voisin germanique nettement plus importante en Flandre. Pas grave, les Flamands ont donc construit une nouvelle tour de l’Yser, deux fois plus grande, devenue point de rencontre traditionnel des extrémistes du nord, parfois très très bruns…
Bonne chance pour parler des “facilités” dans le prochain chapitre. C’est tout sauf facile.
PdF
, le 10.05.2010 à 16:09
Merci, Franck, très intéressant article.
Et de quand date l’annexion de la France par la Belgique ?
bin oui, quand on achète n’importe quel produit en grande surface en région parisienne (papier toilette, eau minérale, produits d’entretien –c’est à peu près tout ce que j’y achète– ), les étiquettes sont toutes bilingues français/flamand, et ça m’agace !
z (déjà que j’ai du mal avec les grandes surfaces, je répêêêêêêêêêêêête : notez que je n’ai rien contre le flamand, hein…)
, le 01.06.2010 à 08:45
Je reviens sur cet article
grâce à la vitesse retrouvée du sitepour remercier Frank Pastor, et me demander si l’on ne va pas devoir faire un Cuk Day à Tournai, car j’y habite également!, le 27.06.2010 à 20:26
Merci pour ce très intéressant article ! Quoique frontalier (et de la Flandre) je n’ai jamais très bien compris la question linguistique belge ;-)