Chapitre précédent: Les chapitres précédents d’un roman policier sont trop difficiles à résumer. Nous y renvoyons le lecteur: le feuilleton paraît le dimanche et peut être consulté en ligne.
VI
Lorsque je repense aux événements de cet automne-là, j’ai l’impression que les choses se sont succédé à un rythme soutenu. Mais en consultant mes notes pour écrire ce rapport, je constate que ma mémoire me joue des tours. Entre le départ des Blumenstein et l’événement suivant il s’est passé près d’un mois.
Non que je n’aie rien fait. Entre l’Étude et mon agence, je travaillais littéralement jour et nuit.
Entre autres choses, j’ai préparé une demande officielle au nom de l’Étude: Maître Tissot voulait voir le compte ouvert par son père à la défunte Banque de Crédit, absorbée depuis par une plus grande banque. La politique officielle des banques étant qu’elles n’ont plus d’archives, ce genre de demande a peu de chances d’aboutir. Maître Tissot le savait, mais il tenait à ce qu’on fasse tout de même la tentative.
Ses rapports avec moi étaient distants. De toute évidence, il ne savait pas comment me reparler de la visite à son père. Je n’ai pas insisté, je comprenais son embarras.
Il n’avait pas du tout fait le lien entre le vieil Albert et la mort de Bertrand Perrier. J’ai compris pourquoi le jour où Françoise May m’a appris entre deux portes, au hasard d’un bavardage, que si Perrier avait été engagé, c’était justement parce qu’il avait rencontré Albert Tissot au club de vol à voile, qu’il lui avait dit être à la recherche d’un poste de stagiaire; le père Tissot – qui le voyait depuis des années au club – l’avait recommandé à son fils. Pour Jean-Bernard Tissot, le rapport s’arrêtait là. Son père s’était trouvé au club le jour de l’accident? Si par hasard il l’avait appris, il n’avait trouvé là rien d’exceptionnel: le club, c’était le dada de Papa.
Cesco a fini par percer le secret du disque dur de Perrier, mais j’ai été déçue du résultat. Aucune révélation. Il y avait bien une liste d’archives, mais tout ce qu’elle m’a appris c’est que cela commençait en 1934 (une boîte), qu’en 1935 il y avait trois boîtes, en 1936 trois également, puis que cela augmentait plus ou moins vite, jusqu’en 1959 (neuf boîtes).
En repensant à cette période, je constate que je devais être épuisée par les voyages, par le double travail (aucun de mes clients lausannois ne s’est aperçu que je passais trois jours et demi par semaine à Genève). J’aurais dû songer plus tôt à des vérifications auxquelles j’ai procédé plus tard, et qui font généralement partie de ma routine. Mais Léon n’était pas là, j’attendais les résultats définitifs de l’expertise de la lettre – bref j’avais mille raisons apparentes de laisser courir.
Je n’ai cependant pas tort de penser que les biens disparus des Juifs et leurs comptes vacants remplissaient ma vie. Pratiquement pas un jour ne se passait sans qu’il en soit question. Les avis étaient partagés sur la question, et les discussions d’autant plus vives.
Pour les uns, les banques s’étaient contredites, avaient été contredites par des faits, des documents, des témoignages, elles refusaient d’admettre leurs responsabilités, se cachaient derrière le travail des commissions d’historiens qui se plongeaient dans les archives. Pour les autres, tout ça venait du manque de sérieux, de l’arrogance des Américains. C’était une conspiration pour détruire les banques suisses au profit des établissements bancaires américains.
Des films documentaires, des livres venus des horizons les plus divers démontraient pièces à l’appui que les banques suisses avaient abrité – et pas toujours rendu – «l’argent du crime» (Tom Bower), qu’elles avaient été «les banquiers d’Hitler» (Adam LeBor). Et puis il y avait le rapport Eizenstat (du nom du sous-secrétaire au commerce des États-Unis qui en avait assumé la responsabilité), établi par une commission d’historiens chargée par le gouvernement américain de faire toute la lumière. Et en Suisse même historiens, sociologues, parlaient du «Bonheur d’être Suisse sous Hitler» (Jean-Baptiste Mauroux), de «La Suisse, l’or et les morts» (Jean Ziegler), et ainsi de suite.
Les auteurs suisses étaient balayés d’un revers de la main: des gens en quête de publicité. Les documentaires suisses ont été décrétés unilatéraux. Les films et livres étrangers ont été taxés de diffamatoires et ignorés partout où cela était possible.
Quant au rapport Eizenstat, le chef d’une calamiteuse «Task Force» helvétique censée ripoliner «notre» bonne réputation s’était permis de dire, hardiment: «Le rapport … [dit Eizenstat] ne procède pas toujours à la critique des sources qu’on est en droit d’attendre. En effet, il ne suffit pas de résumer les documents et d’en indiquer les références. Au moins pour certaines questions controversées ou délicates, il faut les confronter à d’autres documents et les accompagner d’un commentaire». Soyez plus sérieux, Messieurs! Nous les Suisses on va vous apprendre comment on travaille.
On était dans un dialogue (assourdissant) de sourds.
«Balayez donc devant votre porte, qu’avez-vous fait, vous autres, pendant la guerre?» vociféraient les Suisses.
«Ce que nous pourrions avoir fait ne change rien à ce que vous avez fait, vous les Suisses», répondait-on depuis l’Amérique, la Suède, l’Espagne ou le Portugal.
Et on repartait comme en quarante, si j’ose dire.
Le soir, après avoir fait mon travail d’agent d’affaires, je descendais souvent à l’étage en dessous, dans le bureau de Rico.
C’est lui qui me tenait au courant, qui me donnait des documents à lire. Il avait fait l’objet de pressions de Berne (il n’avait pas voulu spécifier davantage) à cause d’un article qu’il avait écrit à propos du journal bâlois «Die Nation», qui pendant la guerre avait – déjà – dénoncé la compromission trop grande avec Hitler. Le rédacteur en chef, Peter Surava, avait payé son franc-parler d’une carrière brisée. Dès 1945, il avait fait l’objet d’une véritable persécution de la part du Conseil fédéral de l’époque. Il avait continué à écrire jusqu’à la fin de sa vie, mais pas des livres politiques, et sous un nom d’emprunt. Cela ne faisait que quatre ou cinq ans qu’il avait publié ses Mémoires sous son vrai nom.
«Si ça continue, mes articles finiront par me coûter cher, à moi aussi. Il faut que je pèse mes mots», soupirait Rico.
Pour l’instant, il travaillait plus dur que jamais.
Dans le train, une conversation sur deux roulait sur les fonds juifs.
On ricanait de ce que le sénateur républicain de New York Al D’Amato faisait sa campagne électorale «sur le dos» des survivants de l’Holocauste.
«C’est peut-être vrai», m’a dit un journaliste de télévision en face de qui je faisais assez souvent les trajets entre Lausanne et Genève. «Mais les faits qu’il a rendus publics sont exacts. Il a à son service une équipe de chercheurs tout à fait remarquable. Quels que soient ses motifs, cela ne change pas les faits.»
«Mais cela change quelque chose à la noblesse de sa cause.»
«Combien d’années, de décennies même, les survivants de l’Holocauste ont-ils passées à réclamer leur dû sans que personne ne les écoute? On ne peut pas les blâmer d’avoir profité de l’occasion. D’Amato fait peut-être ça pour conquérir des voix juives à New York, mais le fait est qu’à New York il y a beaucoup de Juifs, et que plus d’un attend qu’on lui rende justice. Ils se rendent mutuellement service.»
Évidemment, si je repensais aux Blumenstein, je n’avais pas grand-chose à répondre. Et il me paraissait que si certains des avocats des lésés avançaient des prétentions absurdes, c’était que la peur de devoir ouvrir leurs coffres a poussé les banques à se défendre au-delà du raisonnable.
Parfois, j’avais l’impression, lorsqu’on noircissait la réputation de «la Suisse», d’être prise en otage: on parlait vraiment de nous comme si nous étions tous coupables. Et, une fois de plus, je repensais à ce qu’avait dit Judith Blumenstein.
Pour couronner le tout et accroître cette impression de continuité en dépit du fait que je ne me suis guère occupée des Blumenstein pendant plusieurs semaines, la rédaction d’un des hebdomadaires pour lesquels il travaillait a donné pour consigne à Rico: «Trouve d’autres Meili, des gens que le grand public ne connaît pas.»
Au fil des semaines, il les trouvait, et lorsque nous nous voyions (relativement souvent, il faisait ses recherches sans quitter la Suisse, presque sans quitter Lausanne), il n’était le plus souvent question que d’eux.
J’ai ainsi appris, avec quelques semaines d’avance sur les lecteurs de l’hebdomadaire, l’histoire de Carl Lutz. Ce dandy bâlois était homme d’affaires, et pendant la guerre il était Consul de Suisse à Budapest – en principe ça aurait dû être à peine plus qu’un poste honoraire. Mais après l’occupation allemande de la Hongrie, Carl Lutz et sa femme s’étaient rendu compte qu’ils avaient en main un moyen efficace de sauver des Juifs: leur donner un visa pour la Suisse, ce qui les mettait sous protection consulaire. Ils avaient ainsi, de leur propre initiative, distribué des milliers de visas, et des décennies plus tard Madame Lutz se souvenait encore de leur tourment parce que des milliers, ce n’était pas suffisant, les Juifs continuaient à être expédiés dans les camps de la mort par trains entiers.
«Carl Lutz a sa rue en Hongrie, en Israël. En Suisse, après la guerre, il a reçu un blâme pour avoir distribué des visas sans respecter la procédure établie, et il a été privé de sa qualité de consul», a conclu Rico.
La première fois où l’on a parlé positivement de Carl Lutz en public, c’était à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, en 1995. Il était mort depuis longtemps.
Rico m’a également raconté l’extraordinaire histoire, oubliée en Suisse, d’un autre Meili, Louis Haefliger. Un petit homme à l’allure insignifiante, j’ai vu sa photo.
Il avait vingt-quatre ans et il était employé de banque lorsqu’en avril 1945 il s’était porté volontaire pour une mission de la Croix-Rouge: il avait été envoyé en Autriche (qui faisait partie du Reich allemand pour quelques jours encore), pour apporter des vivres à Mauthausen. Il était arrivé à destination le 28 avril et avait vainement tenté de distribuer sa marchandise aux prisonniers, les SS l’en avaient empêché. Il avait fait intervenir la Croix-Rouge allemande, s’était entêté, et finalement, parce qu’il refusait à la fois de partir et de lâcher ses camions de vivres, on l’avait casé au mess des officiers en attendant de régler son cas. On lui avait même donné un lit: il partageait sa chambre avec un officier nommé Riemer (employé de banque au civil, lui aussi). Et c’est Riemer qui lui avait appris – de collègue à collègue – les ordres d’Himmler: faire sauter l’usine Messerschmitt qui se trouvait sous le camp, non sans y avoir parqué d’abord tous les prisonniers et tout le village avoisinant pour qu’il ne reste pas de témoins.
La veille du jour où le plan devait être mis à exécution, Haefliger a réussi à persuader Riemer que c’était de la folie, et avec la voiture de l’officier allemand sur laquelle ils avaient peint une croix rouge sur fond blanc, avec son mouchoir en guise de drapeau blanc, et Riemer pour chauffeur, Haefliger s’est mis à battre la campagne à la recherche des Alliés. Un acte d’un courage inouï: la zone grouillait de militaires des deux camps. Avant de partir, Haefliger a même trouvé le moyen de contacter le comité de prisonniers de Mauthausen et de donner des consignes: lorsqu’ils verraient les Alliés poindre à l’horizon, il fallait que les prisonniers se ruent sur les gardes et les désarment par surprise, pour les empêcher de tirer.
Haefliger n’a rencontré que deux chars américains, commandés par un sergent d’origine polonaise, partis en éclaireurs pour vérifier l’état des routes. Le reste de la division était assez loin en arrière.
À eux deux, Haefliger et le sergent – il s’appelait Al Kosiek – ont réussi à bluffer les SS, à libérer le camp avec l’aide des prisonniers. Quarante ans après, Louis Haefliger disait encore, avec fierté: «Ce dont je m’enorgueillis, c’est que le camp a pu être libéré sans qu’un seul coup de feu soit tiré.»
Rico m’a raconté tout cela un soir à table. Dans un grand geste, il s’est essuyé la moustache.
«Et que crois-tu qu’il soit arrivé à Haefliger lorsqu’il est revenu à Genève?»
«Une réception de héros?»
«Tu n’y es pas, ma pauvre vieille! Il a été radié de la Croix-Rouge pour faute professionnelle.»
«Quelle faute professionnelle?»
«Un délégué de la Croix-Rouge n’a pas le droit de faire appel à un des belligérants.»
«Mais enfin, les circonstances…»
«Le règlement c’est le règlement. Il a empêché la mort de trente mille, de cinquante mille, de cent mille personnes, peut-être. Mais que veux-tu, c’était contre le règlement.»
«Et ensuite?»
«Oh, entre-temps il est mort. Il a sa rue en Israël, lui aussi, et en Autriche. On lui a attribué toutes sortes d’honneurs, l’Autriche l’a proposé deux fois pour le Prix Nobel de la paix.»
Rico a levé son verre.
«À Haefliger!»
J’ai levé le mien vers le ciel:
«Santé, Louis. Et comment se fait-il qu’en Suisse on ne parle pas de lui?»
«On lui a consacré un documentaire dans les années quatre-vingt. Mais après la guerre il s’est retrouvé sur une liste noire, il n’arrivait pas à obtenir un job, il a dû émigrer, il est devenu citoyen autrichien, et il a fini sa vie à Vienne. “ Nous l’avons oublié.»
Plus d’une fois, Rico avait réussi à me faire pleurer: lorsqu’il m’avait raconté que Madame Lutz – morte récemment – faisait encore des cauchemars cinquante ans après, parce qu’elle pensait non pas aux Juifs que son mari et elle avaient sauvés, mais à ceux qu’ils n’avaient pas réussi à protéger. Ou lorsqu’il m’avait lu un document qui relatait comment les prisonniers de Mauthausen, des squelettes ambulants, avaient joué l’hymne national américain avant même d’avoir été nourris et soignés, pour remercier leurs libérateurs.
Bref, avec tout ça, subjectivement je n’ai pas eu la sensation que mon travail pour les Blumenstein s’était interrompu.
Je continuais à préparer les dossiers pour Maître Tissot, j’allais au tribunal avec lui. Et c’est un soir où il fallait à tout prix que je termine un document dont nous avions besoin pour l’audience du lendemain matin que Bertrand Perrier, fatigué sans doute de me voir tourner en rond, m’a fait un signe depuis l’au-delà.
Je ne suis pas mystique pour deux sous, mais j’avoue que, lorsque je pense à ce moment-là, je ne peux m’empêcher de me dire qu’il m’a mis une main sur la nuque et dit, dans le langage spécial des gens qui ne sont plus des nôtres: «Regarde, ma vieille, et vois.»
Le matin même, la grande banque qui avait absorbé la Banque de Crédit avait répondu à Maître Tissot qu’elle regrettait, et cætera. Avec copie à Albert Tissot, qui avait après tout été titulaire du compte. Et c’est à cela que je pensais lorsque je me suis mise en quête d’une agrafe – aussi bête que ça. Il n’y en avait plus dans mon tiroir. Il devait être sept heures, il n’y avait plus personne dans la maison, sinon la femme de ménage dont j’entendais l’aspirateur.
Je pourrais sans doute en récupérer une dans mes dossiers. J’ai ouvert le tiroir du bas, j’ai feuilleté les dossiers suspendus, trouvé ce que je cherchais, j’ai enlevé le trombone de la main gauche, et au moment de refermer le tiroir, il m’est tombé des doigts et a glissé sous les dossiers suspendus. J’ai passé la main sur le fond du tiroir, à l’aveugle. Rien. Je suis allée un peu plus loin vers l’arrière, et mon doigt a rencontré quelque chose. J’ai tiré.
C’était un calepin oblong de cuir brun, un agenda. J’ai continué à chercher au fond du tiroir, et j’ai récupéré mon agrafe.
J’ai refermé, j’ai ouvert le calepin. Sur la page de garde il y avait le nom, à l’encre verte: «Bertrand Perrier.»
Ça m’a fait un coup. Comment avais-je pu manquer ce carnet le premier jour? Il était assez plat, et de la même couleur que le tiroir, c’était sans doute pour ça.
C’était un agenda de l’année en cours, avec des rendez-vous jusqu’au jour même où Perrier avait été tué. Plusieurs fois, il avait écrit la lettre S entourée d’un cercle. Sur le jour où il était mort, il avait noté: «Planeur, 2 heures.»
«Pauvre vieux, va. Et pauvre Stéphanie.»
J’allais fermer l’agenda, le ranger dans le tiroir, j’étais crevée, je m’en occuperai demain, lorsque j’ai remarqué une feuille coincée derrière le petit cahier des adresses séparé de l’agenda proprement dit. Je l’ai sortie, l’ai dépliée.
Il m’a fallu un instant pour comprendre.
C’était, imprimée sur papier, la liste des archives que j’avais trouvée dans l’ordinateur. Mais elle était différente de l’original électronique. Elle avait été complétée à la main. Elle était recouverte d’une écriture serrée. En haut, il avait écrit «Squat», à mi-feuille sous un grand trait noir, à partir de 1948, «Versoix».
À côté de chaque année, il y avait des noms. De 1936 à 1940, il y avait, entre autres, celui des Blumenstein. Cohen revenait également plusieurs fois. Qu’est-ce que…
J’ai repris l’agenda, je l’ai lu page par page. Rien qui m’illumine. À la page de garde, sous le nom de Bertrand, il y avait son adresse: 24, boulevard des Philosophes. Et juste dessous, comme dans beaucoup d’agendas, la rubrique «Personne à prévenir en cas d’accident». Cette personne, c’était Madeleine Fabbri, Versoix (mère). Il y avait un numéro de téléphone. Pathétique. Demain, je m’occuperais…
C’est venu comme un coup de massue: ces idées dont on ne sait pas d’où elles sortent. J’avais lu le nom de Blumenstein. Tracé des mois avant qu’ils ne se manifestent. Perrier avait fouillé, lu les archives – il n’aurait pas pu connaître ces noms sans cela.
Il a fallu encore cinq minutes pour que la question surgisse enfin: étais-je sûre qu’il les avait détruites?
Je n’ai pas dormi de la nuit. Il fallait que je me débarrasse de mon pensum au tribunal, Maître Tissot comptait sur moi, je n’avais même pas le temps d’appeler Sophie avant d’aller au Palais de Justice, où je devais être à huit heures, j’ai dû prendre le train à l’aube, on n’arrive pas en retard au tribunal.
Qu’on ne me demande pas ce qui s’est passé ce matin-là. Mon corps, mes réflexes y étaient. Ma tête était ailleurs. Heureusement c’était jeudi, à midi j’avais fini ma semaine.
Avant de quitter l’étude, j’ai photocopié l’agenda page par page, à tout hasard.
À une heure, depuis une cabine, j’appelais Madame Fabbri, la mère de Perrier.
«Allô? Madame Fabbri? Madame Fabbri, je suis désolée de vous déranger. Je suis Marie Martin, c’est moi qui ai remplacé votre regretté fils…»
«Je n’ai pas…»
La voix était sèche. Je ne voulais pas qu’elle m’envoie paître. Il fallait que je la voie.
«Je suis désolée, mais c’est que par hasard, j’ai retrouvé son agenda, il s’était glissé derrière les dossiers suspendus. J’ai pensé que vous aimeriez le récupérer.»
Elle s’est adoucie d’un rien.
«Vous me l’envoyez?»
«Si vous permettez, je vous l’apporte.»
«Mais ça vous fait perdre du temps.»
«Pas du tout, cela me ferait plaisir. Je pourrais venir dans une heure, je passe par Versoix.»
C’était façon de parler, les trains que je prends habituellement ne s’arrêtent pas à Versoix.
Elle a accepté.
Madeleine Fabbri était une femme encore jeune, belle, soignée. Mariée avec un architecte, Paolo Fabbri, ai-je constaté sur la boîte aux lettres. Elle m’a reçue dans un appartement meublé avec goût, simple et magnifique.
Elle m’a fait asseoir, m’a offert à boire.
Une fois les préliminaires achevés, j’ai ouvert mon sac.
«Voilà l’agenda, Madame, je me suis dit…»
Madeleine Fabbri l’a pris comme on prend une fleur que l’on craint d’abîmer, l’a feuilleté, s’est arrêtée comme moi au jour où Bertrand est mort.
Et d’une voix tremblante, elle a murmuré, pour elle-même:
«Je n’ai jamais cru à un accident, moi.»
Elle s’est mordu les lèvres, comme si elle en avait trop dit. J’étais à court de mots, et pendant un temps qui m’a paru très long, nous nous sommes regardées.
Il fallait que j’en aie le cœur net. Je me suis lancée.
«Qu’est-ce qu’il a caché chez vous, Madame Fabbri?»
Elle n’a pas bronché.
«Qu’est-ce qui vous fait dire qu’il aurait caché quelque chose chez moi?»
«Vous soupçonnez qu’on ait provoqué l’accident de votre fils, il faut bien qu’il y ait une raison. Et puis il y a ça.»
J’ai sorti la photocopie de la liste. Madeleine Fabbri l’a prise, l’a parcourue. Je me suis dit qu’elle allait pleurer.
«Il a écrit “ Versoix ”», ai-je remarqué d’une voix incertaine.
«Je ne vois pas». Son ton était neutre.
«Madame Fabbri, si vous soupçonnez qu’on a fait du mal à votre fils, vous n’allez pas rester là, les mains croisées, à ne rien faire. Vous êtes la seconde personne qui me parle d’accident provoqué. Il faut bien qu’il y ait quelque chose. Je comprends bien que vous n’avez aucune raison de me faire confiance…»
«En effet. Vous pourriez être n’importe qui. La maîtresse de Maître Jean-Bernard Tissot, par exemple.»
Je n’ai pas relevé. Elle avait toutes les raisons de se méfier.
«Votre fils habitait chez vous, lorsque…»
«Il a quitté la maison très jeune, pour aller à un endroit appelé Rhino, ne me demandez pas où c’est, je n’y ai jamais mis les pieds, en ce temps-là nous étions en froid. Il n’acceptait pas que je me sois remariée après la mort de son père. C’est seulement depuis peu que…»
Sa voix s’est cassée.
«Je suis désolée, Madame. Je ne voulais pas… Voulez-vous me permettre de vous inviter à dîner? Vous êtes seule ici…»
Elle a longuement fait non de la tête, puis elle a récupéré sa voix.
«Ne vous en faites pas. Mon mari rentre tout à l’heure.»
Un silence.
«C’est à cause de lui que je me suis brouillée avec Bertrand, après la mort de mon premier mari», a-t-elle fini par dire comme si elle me faisait une concession. «Il était jaloux… Bertrand n’aimait pas Paolo Fabbri parce que personne n’arriverait jamais à la cheville de son père. Je dérogeais, selon lui.»
«Que faisait votre premier mari?»
«Il était commissaire de police. Un redresseur de torts. Bertrand tenait de lui.»
C’était peut-être une explication de sa témérité.
«Je suis vraiment désolée…»
J’avais conscience de me répéter, mais devant cette émotion violente et complètement retenue, je ne savais plus que dire d’autre.
Elle s’est levée, le visage fermé, la voix dure.
«Il vaut mieux que vous partiez. Pour vous. Pour moi. Pour tout le monde.»
Elle ne me mettait pas physiquement à la porte, mais c’était tout comme.
Je suis allée à la gare de Versoix attendre l’omnibus qui m’a amenée à Nyon, où j’ai pris un train un peu plus rapide.
Je me suis retrouvée face à Sophie vers quatre heures de l’après-midi. Je lui ai tout raconté.
«Incroyable», a-t-elle dit plusieurs fois, les yeux fixés sur la liste d’archives (de celle-là, j’avais gardé l’original).
J’étais furieuse de me sentir aussi impuissante.
«Il faut absolument obtenir une liste des comptes ouverts par Albert Tissot», ai-je remarqué.
À Lausanne, j’aurais su à quelles portes frapper. Mais à Genève?
J’ai appelé Pierre-François pour le mettre au courant et lui demander conseil. Sa secrétaire m’a appris qu’il était déjà parti – euphémisme, on se demandait parfois quand Pierre-François était à son étude. Il devait pourtant y passer un certain nombre d’heures, l’efficacité de ses interventions en témoignait.
«Il m’a dit qu’il allait voir Monsieur Girot à Vevey.»
Ah, ah! Il était chez les forains. Je me suis précipitée à Vevey. Une fois qu’on sait dans quelle localité ils sont, on trouve les forains sans problème, ils prennent de la place. Ils étaient tout juste encore là. Ils démontaient. Nous étions en novembre, c’était le moment de leur pause avant les grands bastringues de fin d’année.
Je les ai trouvés dans la roulotte de l’oncle Girot. Autrefois Jacky Girot avait exécuté un numéro sensationnel: le mur de la mort, à moto sur une paroi verticale, un truc à vous faire frémir avec voltiges, équilibre assis sur le guidon, debout sur la selle. On l’appelait l’homme aux quatorze prouesses.
«Je ne sais pas qui a inventé ça, ça venait d’Allemagne», aimait-il à raconter. «Il faut une concentration terrible. On part sur le mur à trente-cinq ou quarante kilomètres à l’heure. Au bout de trois mètres, tu es déjà sur la paroi. Et une fois que tu y es, il n’y a pas quelque chose de plus ou moins difficile, ou tu sais le faire à cent pour cent, ou tu ne sais pas. J’ai fini par arrêter au bout de dix ans, parce que c’est un risque terrible, ça t’abîme la santé.»
Il avait eu plusieurs accidents. Un jour il avait eu la sensation qu’au prochain il se tuerait. Il avait changé d’occupation. Maintenant il devait avoir près de soixante-dix ans, mais il avait gardé ses allures de boxeur funambule. Il était attablé avec sa femme Lucie, leur fils Daniel, qui est un de mes bons amis, et leur neveu, Pierre-François Clair, qui est – on l’aura compris – mon avocat préféré. Ils sirotaient une bouteille de blanc.
Ils m’ont fait une place à la table.
«Que nous vaut l’honneur…?»
«J’avais besoin de voir Pierre-François.»
«Une affaire? Tu veux qu’on sorte?»
J’ai eu un instant d’hésitation. Mais après tout je n’avais pas de client à proprement parler, et puis les Girot – Daniel en particulier – m’avaient souvent aidée. Ils faisaient pour ainsi dire partie de mon agence.
Je leur ai raconté la mort de Perrier, mes soupçons, l’histoire de l’agenda. J’attendais un conseil de Pierre-François. L’aide est venue d’une source inattendue.
«La mère Perrier m’a dit: “Il est allé habiter un endroit appelé Rhino.” Je voulais aller voir, mais je ne trouve ça sur aucune carte, il va falloir que je la rappelle pour lui poser la question.»
«Où est-ce que tu vis, Marie?» s’est esclaffée Lucie, «bien sûr que tu ne le trouves sur aucune carte. C’est le nom d’un des squats de Genève. Il est célèbre.»
«Un squat! Tu es sûre?»
«Oui, je suis sûre. Nous, on passe l’hiver à Versoix, on lit donc les journaux de Genève. C’est un squat dont on parle, je te dis, parce qu’ils y ont fait des trucs sensationnels: ils ont une cave à musique, un bistrot, au fil des ans ils ont produit des peintres, des écrivains, des cinéastes, des photographes, des musiciens, et je ne sais quoi encore. Bref, je suis sûre.»
Elle a repris son souffle, et Daniel a complété.
«Et puis on sait tout ça parce qu’il y a un de nos malabars occasionnels, qui habite à Rhino. J’y suis même déjà allé. Richard Maret, tu vois? L'intellectuel, tu te le rappelles?»
«Oui, oui…»
Les malabars, dans le vocabulaire des Girot, ce sont les costauds qui font les gros travaux, montage et démontage des métiers, entretien, surveillance. Certains d’entre eux sont engagés à l’année, d’autres de façon intermittente. Je me souvenais de Richard parce qu’il avait des allures de lutteur de foire, des mains en battoir, un tatouage sur les biscotos, bref tout de la gouape, et qu’un jour où je me trouvais là pendant que les forains s’installaient à Ouchy, il m’avait dit, comme ça en passant:
«Je viens de réussir mon bac.»
«Bravo! Et qu’est-ce que vous allez en faire?»
«Hautes études économiques et informatique. Je me suis inscrit à Genève.»
Il s’était éloigné d’un pas nonchalant, portant sur l’épaule, comme si c’était un oreiller de plumes, une barre de métal qui devait peser cinquante kilos.
«Et il serait où à Genève, ce Rhino?» me suis-je enquise auprès des Girot.
Daniel a feuilleté un épais cahier plein d’adresses.
«Voilà. Richard Maret. 24, boulevard des Philosophes.»
«Quoi?» J’ai eu un geste de surprise si violent que j’ai renversé mon verre de blanc. D’instinct, je me suis levée.
«Mais qu’est-ce qu’il te prend, Marie? Calme-toi. Assieds-toi. Qu’est-ce qu’il y a?»
«Il y a que 24, boulevard des Philosophes, c’était l’adresse de Bertrand Perrier au moment où il est mort. Sa mère a vraiment dû détester ce squat. C’est encore là qu’il habitait, mais elle ne me l’a pas dit.»
À leur tour d’être surpris. Nous nous sommes regardés, avons échangé des sourires entendus. Il n’y avait plus qu’à y aller. C’était l’évidence même.
(à suivre)
© Bernard Campiche éditeur, CH 1350 Orbe (Suisse)
«D’Or et d’Oublis» a été réalisé par Bernard Campiche, avec la collaboration de René Belakovsky, Mary-Claude Garnier, Marie Musy, Marie-Claude Schoendorff et Daniela Spring. Photo de couverture: Laurent Cochet
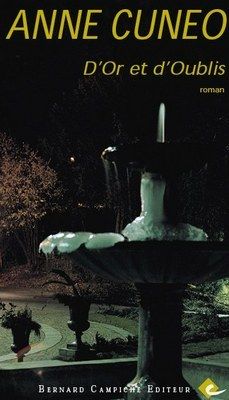
, le 21.12.2008 à 09:17
Ah, les petites histoires de la “grande histoire”…
C’est redoutable.
z (le matin, au réveil, heureusement que mon naturel optimiste va plutôt retenir le courage des individus, je répêêêêêêêête : sinon, c’est à se taper la tête contre les murs…)